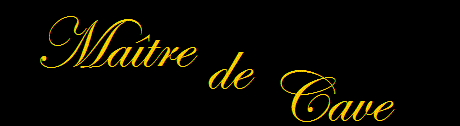
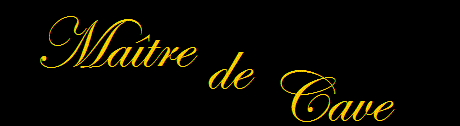 |
La gestion d'une cave à vin.
Travail et responsabilités du sommelier en milieu de restauration
|
Compte rendu d'une conférence donnée le 13 février
2012 aux étudiants de |
|
|
1
LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DU SOMMELIER
1.1
En établissement
Le sommelier est beaucoup plus qu’un serveur de vin. Il est responsable
de l’espace vin, que ce soit un petit cellier ou une grande cave à vin.
Il doit s’assurer de la rotation des stocks, faire la carte des vins,
suggérer des accords mets et vins en collaboration avec le chef et il
doit tenir informés les autres membres du personnel. Les sommeliers
sont les spécialistes les plus connaisseurs de l’industrie du vin et les
autres membres du personnel comptent sur eux pour les assister auprès
de la clientèle et pour le service du vin. Il est la personne ressource
en matière de vin.
Les ventes et la rentabilité d’un établissement sont sa raison d’être et
un sommelier compétent se doit de faire hausser le chiffre d’affaires
d’un restaurant en s'appuyant sur son savoir et ses expériences. En termes de gestion et de savoir, le sommelier devra établir des objectifs et des politiques d’entreprise en matière de vin et de conservation et stockage de celui-ci.
Des produits de qualité
En restauration, il n’y a pas de compromis à faire sur la qualité. Que
ce soit un restaurant branché, huppé, ou le petit restaurant de
quartier, les clients s’attendent à de la qualité.
Même les petits vins doivent être intéressants. Ils manqueront
parfois de finesse, ils ne seront pas très évolués, mais ils doivent
toujours rester agréables à boire. Des produits originaux, à faire découvrir
Le sommelier doit toujours rester à l’affut des tendances et des
nouveaux produits. Parfois il doit faire redécouvrir des produits à ses
clients.
Les vins peuvent toujours être regroupés. Que ce soit par cépage, par
région, par méthode de vinification: les vins sont tous différents, mais
appartiennent à des familles de styles. Le sommelier doit connaître
ses stocks de A à Z pour être en mesure de bien guider et répondre à la
demande de ses clients. Si le client sait déjà ce qu’il veut, le rôle du
sommelier consistera alors à lui suggérer, s’il est réceptif, un vin qu’il
jugera supérieur ou quelque peu différent, tout en restant dans la même
gamme, afin d’offrir à son client une nouvelle expérience de
dégustation. Il pourra par la même occasion pousser la vente de produits
plus lucratifs.
Le travail du sommelier implique un travail de
recherche constant. Habituellement, les représentants des différentes
agences défileront à son établissement pour lui faire découvrir
différents produits. Mais il ne devra pas s’en tenir qu’à ça. Il devra
toujours être à la recherche de nouveaux produits, de nouvelles
découvertes et, pour y parvenir, il devra lire les revues spécialisées et
assister aux différents salons et dégustations.
Il est important d’assurer une présence auprès des clients et tout le
personnel de la salle devrait y être sensibilisé. L’alcool ne peut être
vendu sous pression. Les lois et la morale nous interdisent de faire des
promotions et de pousser les ventes dans ce sens. Les sommeliers et les
serveurs ne peuvent que suggérer, offrir et être à l’écoute des besoins
de leurs clients.
Par contre, si la quantité est difficile à promouvoir, il en va tout
autrement de la qualité. Il est tout à fait pertinent d’inciter les
consommateurs à acheter un vin de gamme supérieure et le meilleur moyen
de le faire est de former le personnel. Si vos employés savent quels
sont les coûts nécessaires à l’élaboration d’un vin de qualité et s’ils
peuvent expliquer la provenance et les caractères du produit, ils seront
probablement plus en mesure d’inciter le consommateur à acheter une
meilleure bouteille.
Les clients néophytes ont parfois de la difficulté à différencier un vin
extraordinaire d’un autre plus ou moins raffiné. Mais ils n’auront
aucune difficulté à différencier un bon service d’un mauvais. Une carte des vins bien conçue et bien présentée
Plus que pour tout autre produit de consommation, l’appréciation d’un vin est
tributaire de l’environnement et du contexte. Par exemple, nous avons
tous apprécié un vin lors d’un voyage dans une région particulière. Mais
lorsque nous rapportons ce même vin, que nous le buvons au retour de
notre voyage dans un environnement différent avec d’autres personnes,
ce vin qui nous avait semblé extraordinaire peut s’avérer finalement
bien ordinaire. Si le personnel d’un restaurant réussit à faire vivre une
expérience unique à ses clients, il va s’assurer que celle-ci restera gravée
dans leurs mémoires.
Le sommelier et le personnel d’un établissement
font partie de l’expérience qu’un client vient vivre et son appréciation
des produits qu’il déguste sera proportionnelle à l’ambiance et
l’atmosphère de l’endroit où il aura dégusté son vin.
2.1
Adapter sa carte au menu et à la clientèle
Une bonne carte des vins doit être ciblée, que ce
soit pour un grand restaurant, un restaurant à thème ou un bistrot. Vous
devez tenir compte des préférences du marché local, des tendances
actuelles, de ce qu’offrent vos concurrents et où vous êtes situé. Vous
devez décider de la longueur et du style de votre carte, que ce soit une
carte des vins élaborée, qui nécessite d’avoir une cave bien fournie
avec des vins de garde ou une courte liste de vins de consommation, qui
change constamment ou non et qui dégage des mouvements de
trésorerie.
Les gens qui se présentent dans un restaurant son déjà convaincus. Ils
vont manger et ils ont possiblement l’idée de boire. Inutile de vouloir
les convaincre de faire autrement. Ils ont réfléchi, la plupart du temps,
au montant maximum de leur éventuelle facture et ils ont choisi
l’établissement en fonction de sa réputation, son marketing et sa
politique de prix.
Il faudra s’assurer de répondre à leurs besoins et leurs attentes. Le
prix est l’un des principaux facteurs qui permettront au restaurateur de
satisfaire le client ou de le décevoir… et même de perdre des
ventes si sa politique de prix ne correspond pas aux attentes des
clients.
Deux types de marges bien distincts peuvent être utilisés pour
déterminer le prix de vente des vins : la marge fixe et la marge
variable.
a)
La marge fixe
Pour calculer une marge fixe :
Ce type de marge garantit un bénéfice fixe par bouteille, pour chaque
bouteille de vin vendue.
Toutefois, cette méthode présente l'inconvénient de rendre les vins bas de gamme
souvent beaucoup trop chers pour le client. Par exemple, un Mouton Cadet
à 13,95 $ (TTC) de la SAQ devra se vendre 36,95 $ (13,.95 $ + 20 $ + taxes),
soit 265 % le prix de la SAQ.
À l’opposé, on se rend vite à l’évidence que les bouteilles deviennent
de plus en plus avantageuses pour le client et désavantageuses pour le
restaurateur, au fur et à mesure que vous montez dans les prix de la
carte des vins. Par exemple, un Tignanello à 99,75 $ (TTC) de la SAQ se
vendra 122,75 $. Soit 123 % du prix de la SAQ. Le montant de la marge fixe à appliquer varie d’un établissement à un autre, mais il doit somme toute demeurer concurrentiel.
Une
autre façon de calculer le montant de la marge fixe consiste à additionner tous
les frais relatifs au service du vin (construction de cave, maintenance,
salaires du sommelier, etc.) et de diviser de montant par le nombre de
bouteilles que vous prévoyez vendre durant une même période, en
n’oubliant pas d’y ajouter une marge de profit.
b)
La marge variable
Pour calculer une marge variable:
Le pourcentage établi à appliquer varie d’un
établissement à un autre, mais il doit être concurrentiel.
Une
façon de calculer le pourcentage de la marge variable consiste à additionner tous les frais relatifs au service du vin (construction de
cave, maintenance, salaires du sommelier, etc.) et de diviser le montant par
le montant des ventes que vous prévoyez atteindre durant une même
période, en n’oubliant pas d’y ajouter une marge de profit.
c)
Combinaison taux fixe et variable
Pour calculer une combinaison:
Dans les deux exemples précédents : le Mouton Cadet se vendrait 33,49 $
alors que le Tignanello se vendrait 179,35 $.
Quelle
que soit la méthode que vous décidez d’utiliser, assurez-vous qu’en
définitive, le montant de bénéfice corresponde au budget de votre
restaurant.
2.3
S’assurer d’un approvisionnement suffisant et régulier
La carte des vins doit toujours refléter ce que la cave contient.
Si votre carte des vins est pré-imprimée, il faut vous assurer que votre
réapprovisionnement en produits soit possible. La plupart des produits
réguliers de la SAQ sont assurés sur une base annuelle. Seuls les
millésimes changeront. Il serait donc préférable de ne pas faire
imprimer le millésime sur votre carte des vins. Les agences pourront
vous informer de la disponibilité future des produits.
La plupart des grands établissements disposent
d’une carte avec des pages amovibles qui seront révisées de temps à
autre. Cette flexibilité permet d’offrir des vins plus rares, mais qui ne
sont pas disponibles en tout temps. Ce type de carte permet également
d’inscrire les millésimes sur la carte puisqu’elle sera révisée
régulièrement.
Le sommelier doit connaître ses produits et partager son savoir
avec les autres membres du personnel et sa clientèle. Si le client est
réceptif, il appréciera connaître une courte anecdote sur le vin qu’il
propose à ses clients. Il aimera également que vous preniez le temps
de lui expliquer ce qu’il boit. C’est, pour le client, une façon
d’associer mentalement un vin à une situation; il pourra plus
facilement se souvenir de son expérience gustative et sensorielle, donc, se souvenir de vous ou de votre établissement.
3
STOCKAGE ET CONSERVATION DES VINS
3.1
Facteurs intervenant dans la conservation
d’un vin
La conservation d'un vin dépend principalement des facteurs suivants :
Il ne faut jamais perdre de vue que
le vin est une matière vivante
et qu'il évolue. Sa jeunesse se traduit parfois par une certaine
astringence pour les vins rouges et une pointe d'acidité pour les
blancs. Le vin suit une courbe de maturité gustative et les
chances demeurent fortes que la courbe de la valeur monétaire d’un flacon suive la même
évolution.
a)
Combien de temps peut-on conserver un vin?
On conserve un vin le moins longtemps possible, dès qu’il est prêt à boire,
parce que les
vins coûtent cher et les investissements qu’ils représentent doivent être
rentabilisés.
Certains vins sont prêts à la consommation quelques mois après la
cueillette du raisin : les vins de primeur, par exemple, commercialisés
dès le mois de novembre qui suit la récolte voire dès la mi-octobre pour
les vins de pays primeurs. D'autres, au contraire, sont agressifs,
astringents et instables. Ils doivent vieillir afin de «s'assagir» avant
d'atteindre la qualité première d'un vin : l'équilibre entre ses
différents composants.
La plupart des vins blancs secs et frais (bien pourvus en acidité, de type
Muscadet, Sancerre...), les vins rosés et les vins rouges légers, en
particulier les vins nouveaux ou «primeur» doivent être bus jeunes. Mais
attention aux exceptions, parmi lesquelles il faut citer certains
Chablis.
Les grands vins blancs de la Côte de Beaune, en Bourgogne, mais surtout
les vins mœlleux ou liquoreux du Bordelais, du Val de Loire et d'Alsace
ont souvent une excellente aptitude au vieillissement.
b)
Influence du bois
Jusqu’à récemment, nous pouvions dire que les vins élevés en barriques de
chêne avaient un plus grand potentiel de garde que les vins qui
n’avaient passé aucun, ou peu de temps en barrique. La barrique
permettant de laisser passer une certaine quantité d’oxygène permet au
vin de développer ses qualités organoleptiques et de s’oxyder
légèrement, ce qui favorise sa conservation éventuelle. Cette
notion n’est plus nécessairement vraie…
Des travaux de la station œnologique de Bordeaux
ont démontré que «la bonne oxydation ménagée
de l'élevage des vins en barriques» peut
être assez bien reproduite lors de l'élevage en cuves.
c)
Influence du liège
Le liège est le matériau idéal de bouchage en raison de différentes
caractéristiques :
-
-Il est souple pour pénétrer dans le goulot;
-
-Il est élastique, ce qui lui permet de reprendre sa
forme et d'obturer parfaitement;
-
-Il laisse passer une quantité d’air suffisante pour
permettre aux vins de vieillir;
-
-Il est neutre et imputrescible.
Malgré toutes ces qualités, on rencontre parfois des bouteilles
couleuses. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait : le bouchage mécanique, la pression dans
la bouteille, mais aussi la qualité du liège. En effet, il existe des
lièges de différentes qualités. À partir des meilleurs sont fabriqués
des bouchons longs, qui font généralement 53 mm. Ces bouchons, très
recherchés et très chers, sont utilisés pour les vins de garde. Pour les
vins de table et les vins à boire jeunes sont généralement utilisés des
bouchons de qualité moindre. Il existe évidemment des qualités
intermédiaires.
Souvent : vins de garde = grands bouchons ; vins à boire jeunes = petits
bouchons.
Dans une cave à vin, nous devons garder les bouteilles à l’horizontale
pour garder un bouchon de liège humide. Un bouchon peut prendre
plusieurs mois avant de dessécher et perdre ses qualités de
conservation, mais lorsqu’il est séché, le processus est irréversible et
le bouchon de liège permettra à trop d’air d’entrer dans la bouteille,
causant ainsi une oxydation prématurée du vin.
Attention aux vins (ou alcools) qui contiennent un taux d’alcool trop
élevé. Un taux d’alcool dépassant 20 % risque d’endommager le bouchon.
Il vaut alors mieux les garder debout.
À noter que dans des conditions idéales de stockage, les meilleurs
bouchons ne durent guère qu'une vingtaine d'années. Pour éviter toute
mauvaise surprise, il vaut mieux les remplacer tous les 15 ans, par des
bouchons d'aussi bonne qualité.
Mais il s'agit d'une opération très délicate, qui doit être confiée à un
spécialiste. Le maître de chai de certains grands châteaux du Bordelais
se déplace ainsi chez certains collectionneurs de vieux millésimes pour
effectuer ce changement. Il se déplace dans tous les pays du monde.
- Bouchons synthétiques ou capsules
Les bouchons de liège présentent deux désavantages : le risque de contamination
par le TCA et le risque de couleuses (bouteilles dont le bouchon fuit).
Les bouchons synthétiques évitent ces problèmes en respectant la
perméabilité à l’oxygène qui laisse vieillir le vin.
Il est cependant inutile, mais sans conséquence, de
laisser les bouteilles qui ont des bouchons synthétiques ou des capsules
à l’horizontale. Puisque ces bouchons n’ont pas besoin d’être humides
pour conserver leurs qualités d’étanchéité, les bouteilles peuvent être
entreposées à la verticale.
Certains vins sont obtenus par vinifications courtes : ils sont souples,
bons à boire assez rapidement. D'autres sont élaborés par vinifications
longues : plus charpentés, ils demandent un séjour en cave plus
prolongé.
La vinification a incontestablement une influence sur la conservation
des vins : utilisation ou non de la rafle, durée de macération,
température de vinification, etc. Lorsqu'un restaurateur achète un vin,
il serait souhaitable qu'il se renseigne sur la façon dont le vin a été
élaboré et l'achète en fonction de l'utilisation souhaitée : à consommer
rapidement ou à conserver.
3.2
Millésimes
Dans les grands millésimes, les vins possèdent généralement une bonne,
voire une excellente aptitude au vieillissement. Alors que les vins de
millésimes réputés moyens ou petits doivent se boire plus rapidement.
Gérer une cave à vin implique également la gestion des millésimes.
D’abord, il ne faut pas généraliser; il importe de toujours s’informer. Même dans un
millésime moyen, certaines régions auront mieux réussi. Chaque millésime
aura également son apogée… un meilleur temps pour être consommé. Cinq ans
après sa vinification, il vaut mieux boire un vin de millésime moyen qui
est à son apogée que de boire un vin d’un excellent millésime encore
trop jeune aux tannins durs et aux arômes fermés.
b)
Existe-t-il de mauvais millésimes?
Dans les vieux pays où les règles sont
règlementées, la qualité des raisins dépend du climat. Mais il n'existe
plus de véritables mauvais millésimes. Par contre,
-il
y en existe d'exceptionnels. Grâce aux progrès technologiques, l’œnologie a
réussi à maitriser la vinification et à mieux corriger les problèmes
causés par le climat.
Dans le nouveau monde, l’œnologie est également
présente pour corriger les problèmes. Mais puisque les règlementations
sont moins sévères que dans les vieux pays, il est plus facile de
contrôler les facteurs climatiques, avec l’arrosage et le goute à
gouttes,
entre-autre. L’effet de millésime est
pratiquement inexistant.
Plusieurs organismes, chroniqueurs et spécialistes publient des cartes
de millésimes. Il est facile d’en trouver, mais il faut toujours tenter
de trouver des cartes produites par des entités locales et spécialisées
sur des régions délimitées.
La plupart des châteaux et des grands vignobles publient également des
notes de dégustation et des commentaires relatifs aux millésimes. Même
si ces commentaires sont partisans et souvent motivés par des raisons
promotionnelles, ils peuvent fournir des indications sur le potentiel de garde d’un vin.
3.3
Conditions de stockage
Les comptables vous le diront, les stocks de vins engloutissent une
grande partie du budget d’immobilisation et d’inventaire d’un
restaurant. Nous devons examiner deux éléments différents: l’actif à long terme et l’actif à
court terme.
Le vin est une matière vivante. Il incombe au
sommelier de protéger l’investissement consacré aux stocks de vin. Dans
certains cas, certains vins deviendront même des investissements à long
terme. Mais ils doivent être conservés dans les meilleures conditions
pour pouvoir se conserver… et possiblement se bonifier.
a)
De l’amphore à la bouteille
La fonction première du contenant, pour un liquide, est de pouvoir le
transporter. Si les vins ne sortaient jamais de leurs cuves de
vinification, il faudrait se rendre aux vignobles pour en soutirer et en
boire un verre.
Les générations précédentes ont expérimenté divers contenants, de
l’amphore jusqu’à la bouteille, pour transporter et distribuer
commercialement le vin. Des «Wine in a box» ou viniers ont récemment
été introduits sur le marché, mais c’est la bouteille qui semble le
mieux favoriser le transport et la conservation du vin.
La bouteille par elle-même n’offre pas les conditions optimales de
conservation. Il faut trouver un environnement propice à la conservation
et au vieillissement du vin si on désire préserver son investissement.
b)
L’espace vin : Cellier ou Cave à vin
La cave à vin n’existe plus, ou rarement comme nous la connaissions il y
a 50 ou 60 ans. Même dans les grandes villes de France comme Paris, les
vieilles caves sont rares, car elles ont souffert d’un manque
d’entretien, ou elles ne répondent plus aux critères de conservation en
raison de nouvelles normes de construction et caractéristiques
déficientes comme la vibration causée par le métro, entre autres.
Un espace vin englobe quatre types d’unité de conservation : (www.maitredecave.ca/choix.htm)
c)
Caractéristiques d’une bonne cave
La construction d’une cave à vins doit remplir des conditions
essentielles à la bonne conservation du vin:
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page
www.maitredecave.ca/commentconst.htm.
Il existe principalement deux méthodes pour organiser physiquement une cave à
vin. La méthode européenne demande de placer les bouteilles par région
alors que la méthode américaine demande de placer les bouteilles par
cépage.
-Livre
de cave
e)
Retour et garanties de la SAQ
Au Québec, la SAQ assume la responsabilité de la qualité des vins
qu’elle vend aux particuliers et aux commerçants.
Sur son site SAQ.com, on peut lire :«La politique de remboursement de la Société des alcools du Québec vous
permet d’échanger un produit défectueux ou d’obtenir un remboursement,
et ce, à la succursale de votre choix... Seule condition : il faut
retourner la bouteille remplie aux trois quarts et elle doit avoir été
achetée moins d’un an auparavant.»
Dans le cas d’un produit défectueux, la présentation de la facture est
facultative pour obtenir un remboursement ou un échange.
Cependant, cette politique comporte une exception qui n’est pas
annoncée sur le site de la SAQ même si elle est officielle : le retour
des produits haut de gamme (vieux millésimes, courrier vinicole) sont
acceptés même si la période d’achat remonte à plus d’une année, mais
étant donné le caractère particulier de ces produits, ils ne sont pas
remboursés ou échangés de façon systématique. Une analyse plus
approfondie de la réclamation peut être requise, à cette étape, par une
personne compétente ou le service gestion de la qualité de la SAQ.
4
VINS ET FISCALITÉ
La relation entre les
ventes, le coût des ventes, la valeur des stocks détenus, le taux de
roulement des stocks et la moyenne de la marge bénéficiaire
aidera dans tous les cas à révéler ce qui est
fondamentalement vrai à propos de toute activité commerciale : la seule
entreprise qui en vaille la peine est l’entreprise rentable. Des indicateurs primordiaux vous aideront à connaître
votre position tout au long de l’exercice financier et, surtout,
vous indiqueront clairement si vous déviez de votre objectif de
rentabilité.
Vous
devez savoir comment effectuer l’analyse des coûts et comment calculer
vos prix de vente pour intégrer le bénéfice nécessaire à l’entreprise.
En général, si un vin est plutôt cher, la marge sera moins élevée, et
même si vous recevez moins de pourcentage, vous
encaisserez souvent une somme plus importante que sur les vins moins
chers; toutefois, il faut toujours considérer le roulement dans l’équation. Un
vin qui ne roule pas, qui se vend rarement, n’est pas un vin rentable
même si le montant de profit individuel est intéressant.
4.1
Établir des statistiques de vente et
d’achat
Les restaurateurs qui réussissent bien sont toujours de bons
administrateurs. Ils connaissent parfaitement leur chiffre d’affaire et
conservent des statistiques de vente sur une base mensuelle et
pratiquement hebdomadaire. Ils anticipent toujours leurs ventes et
comparent toujours les résultats d’une année à l’autre en tentant de
comprendre et d’expliquer les écarts, s’il y en a.
Il faut s’organiser et établir des systèmes pour bien garder
l’historique de nos ventes. Que ce soit sur Excel, sur une base de
données ou sur un logicies spécialisé, il faut que le sommelier
maitrise bien son support de données. Il pourra comparer et anticiper
les tendances s’il suit assidument ses statistiques.
Parmi les éléments à anticiper, citons évidemment la gestion du
personnel, mais un des éléments qui s’avèrent également essentiels est la
gestion des stocks. Dans le cas d’un sommelier, c’est particulièrement
la gestion des stocks de la cave à vin qui nous intéresse.
Deux types de gestion de stocks sont à considérer en sommellerie: la
gestion des vins de garde et la gestion des vins de consommation
courante.
a)
-Taux de rendement
Le taux de rendement espéré est le pourcentage que les actionnaires
espèrent recevoir sur leur investissement, alors que le taux de
rendement réel est le profit annuel net qu’ils obtiennent divisé par
l’investissement initial.
Le taux de rendement espéré devrait toujours être gardé en tête et tous
les calculs prévisionnels doivent en tenir compte. Le taux de rendement
est établi par le marché. Un taux trop bas fait fuir les investisseurs
alors qu’un taux trop élevé provoque une compétition excessive. Le
marché a tendance à s’équilibrer de par lui-même.
-Vins de garde
Les vins de garde seront considérés comme une immobilisation dans les
registres comptables et au bilan de l’entreprise. Cela signifie que les
vins achetés pour la garde ne constituent pas une dépense d’opération,
mais plutôt un investissement à long terme, tout comme les chaises, les
tables et les autres actifs à long terme du restaurant.
Pour justifier un investissement en vins de garde, le sommelier doit
être convaincu que l’investissement sera rentable. Il doit s’assurer que
les vins prendront de la valeur et que le coût d’acquisition des vins
jeunes s’avèrera significativement moins élevé que l’achat du même vin
dans plusieurs années. Pour être rentable, l’investissement en vin de
garde doit répondre à certains critères :
-Les conditions de garde doivent être parfaites et
sans risques.
Si les actionnaires de l’entreprise
espèrent obtenir un taux de rendement de 10 % annuel sur leur
investissement, le sommelier doit s’assurer que ce taux sera respecté.
Par exemple, si vous investissez 100 $ sur un flacon, les propriétaires
s’attendront à ce que cette bouteille puisse se vendre :
Et c’est au sommelier que revient la tâche de décider à quel moment la
bouteille cessera de prendre de la valeur et qu’elle devra être vendue.
Vins de consommation courante
Pour les vins de consommation courante, l’idée est complètement
inversée. Dans ce cas, le sommelier cherchera toujours à garder le moins
de vins en cave. Soit que ces vins n’auront aucun potentiel de
s’améliorer avec le temps, soit que les mêmes vins pourront être achetés
à un bon prix dans le futur. En fait, il s’agit de vins qui auront un
taux d’appréciation (Plus Value) égal à zéro ou inférieur au taux de
rendement espéré des propriétaires.
B)
Taux de roulement
Le taux de roulement des stocks (ou taux de rotation) représente le
nombre de fois que vos stocks doivent être renouvelés dans un période
donnée pour répondre à la demande de vos clients. Plus vos stocks seront
élevés et plus bas sera le taux de rotation. C’est donc dire que
plus le taux de rotation est bas, plus vos stocks stagnent… et
il en va de l’investissement qui ne rapporte rien à ses investisseurs. Par exemple, il vaut mieux posséder une quantité de 1 000 bouteilles qui se vendent toutes les semaines (taux de rotation de 52 par année) qu'une quantité de 10 000 bouteilles qui se vendent en 10 semaines (taux de rotation de 5.2 annuellement). En effet, dans le premier cas, si la valeur moyenne des flacons est de 20 $, l’investissement représentera 20 000 $. Alors que, dans le deuxième cas, l’investissement totalisera 200 000 $. Et les deux caves généreront les mêmes revenus… Le rendement sur l’investissement serait donc 10 fois moins élevé avec un taux de 5.2.
Pour calculer le taux de roulement, vous devez procéder en deux étapes : 1. Vous devez calculer le stock moyen que vous avez gardé en réserve durant la période : (stock du début + stock de fin) ÷2. En tenant compte des parenthèses.
Exemple :
2. Vous devez calculer le taux de
rotation des stocks :
Achat en quantité ou en valeur ÷[(stock du début + stock
de fin) ÷2].
Exemple :
Quantité optimale de stocks
Il n’existe pas de règle fixe pour déterminer la quantité optimale de
stocks, mais il est préférable qu’elle soit au minimum, compte tenu de
l’importance des sommes que l’on doit généralement y immobiliser. Pour
déterminer une quantité de stock acceptable, il faut tenir compte de
facteurs comme le délai de livraison, l’espace d’entreposage disponible,
le coût d’occupation de l’espace d’entreposage, les coûts de
manutention, la capacité des vins à supporter l’entreposage, etc.
Surtout, il faudra se référer à ses statistiques des années antérieures pour
s’assurer de répondre à la demande prévue.
L’objectif de tout bon sommelier consiste à maintenir un
taux de roulement élevé en tentant de baisser au minimum
sa
quantité des stocks de vins de consommation, car garder de grandes
quantités en stock coûte très cher.
Concrètement, il est intéressant d'avoir une carte des vins bien remplie, mais si
les produits ne tournent pas, cela peut devenir très rapidement un fardeau
financier insupportable.
4.2
La valeur d’une cave à vin
Une cave à vin ne s’évalue pas de la même façon que les autres actifs
d’un restaurant.
D’un point de vue comptable, la cave à vin de garde ne prend aucune
valeur tant et aussi longtemps que la vente finale n’aura pas eu lieu.
La valeur de votre cave de garde sur vos états financiers représentera la somme
des coûts d’acquisition pour chacune des bouteilles entreposées. C’est
donc dire qu’aucun impôt ne sera perceptible tant et aussi longtemps que
vous gardez vos bouteilles en cave. Votre Château Mouton payé 100 $ il y
a 20 ans ne vous coute rien en impôt même s’il vaut maintenant 2 000 $.
Mais lorsque vous le vendrez, vous devrez payer de l’impôt sur le profit
de 1 900 $. Votre comptable devra d’ailleurs être avisé que vous avez
vendu cette bouteille, car il devra la déduire de vos immobilisations
(les stocks de garde) sur votre état financier à la fin de l’année. D’où
l’importance de garder un inventaire à jour de votre cave.
D’un point de vue pratique, la valeur de votre cave de vieillissement
évolue. Il est important pour le sommelier de surveiller l’évolution du
prix de ces stocks sur les marchés. La valeur du marché peut en effet
guider les propriétaires qui désirent éventuellement vendre leur fond de
commerce. Mais l’évolution de la valeur sur le marché indique également
au sommelier si la bouteille doit être conservée ou si elle doit être
mise en vente prochainement, ou encore liquidée avant qu’elle ne perde
toute sa valeur. Pour suivre l’évolution des prix sur le marché du vin,
le sommelier doit surveiller la concurrence, les revues spécialisées et
les sites internet qui traitent de ce sujet.
4.3
Assurances
Le vin est un bien comme un autre au point de vue des assurances et il
fait partie de ce que les assureurs nomment «le contenu». Dans une
résidence privée aussi bien que dans un restaurant, il faut s’assurer
que «le contenu» sur une police d’assurance est suffisant pour couvrir
les articles divers comme les ustensiles, le mobilier, la papeterie… et
le vin.
Pour éviter toute ambigüité, il est préférable de faire indiquer sur sa
police d’assurance que vous possédez une cave à vin d’un nombre X de
bouteilles. Il est également préférable d’en tenir un inventaire
détaillé et des photos aident toujours à bien documenter un dossier de
réclamation.
Dans le cas d’un sinistre comme le feu, l’inondation ou le vol, il sera
facile de prouver le dommage. Dans des cas où le sinistre n’affecte que
la cave à vin, il faudra probablement demander à un expert sommelier en
évaluation d’expliquer aux assureurs la nature et les conséquences du
sinistre. Par exemple, un système de climatisation déficient qui a fait
geler les stocks… ou, à l’inverse, qui a fait surchauffer les bouteilles. |
|
Accueil Nous rejoindre Boutique en ligne Conseils de construction Sommellerie Gestion des stocks Magasinier Galerie de photos